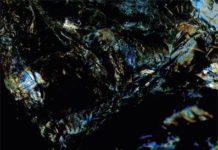San Francisco 1990 : Le rêve hippies et déjà mort depuis des années, et ses principaux héros sont devenus milliardaires, fous, ou ont disparus . Le rock s’est alors réfugié dans d’autres contrés, Seatle avec Nirvana , puis Detroit, ou Jack White bricolaient quelques disques indépendants entre deux restaurations de meubles.
Et puis la vielle flamme s’est rallumée à San Francisco où un groupe de freaks fans des Stones et du Velvet produisirent une tripotée d’albums expérimentaux. Trop alambiqués pour être honnêtes, ces disques eurent au moins le mérite de leurs attirer les faveurs de la presse. Il est vrai qu’on ne pouvait que s’attacher à ce groupe, dont le nom est un hommage au regretté Brian Jones, et qui effectue sa carrière loin des grandes maisons de disques. Mais surtout, c’est en ce moment que le groupe de Newcombe devient particulièrement intéressant, et ce dernier disque est là pour le prouver.
Dans la lignée de son prédécesseur, il renoue avec un certain minimalisme, abandonnant les errements expérimentaux pour retrouver une énergie irrésistible. Ce n’est pourtant pas le minimalisme violent et crasseux d’un Ty Segall que Brian Jonestown développe ici, mais le charme mélodique et sombre du velvet.
La batterie frappe un rythme mécanique, martelant un tempo hypnotisant, avec la régularité d’une usine. La voie de Newcombe nous parvient, lointaine et nonchalante , et rappel presque la voix androgyne de Sunday Morning sur « Tombes Oubliées ». Cette dernière, chantée en français, est la chanson la plus planante de l’album, une sorte de poème hippies au milieu d’un rythme urbain. De « Drained » à « A Word » , l’album fait la part belle à ce rock violent ou poétique , tout en gardant une certaine légèreté mélodique. La formule n’est pas neuve, mais on ne l’avait pas saluée avec tant de brio depuis le premier disque des strokes.
Et encore, les stokes n’avait gardé que la beauté poétique des mélodies velvetiennes , gommant toute violence pour lancer une nouvelle vague mainstream , là où les accords de « Brian Jonestown Massacre », claquent comme des coups de fouet. Et puis le groupe calme le jeu, pour livrer la ballade « We Never Had A Chance ». La guitare se fait alors moins nerveuse, laissant résonner ses accords comme Keith Richard concentré sur la mélodie somptueuse de « Wild Horses ». Car, le groupe a beau rendre hommage à Brian Jones dans son nom, ce titre rappel bien les mélodies voluptueuses de Sticky Finger , le chef d’œuvre du duo Jagger/Richard. « To Sad To Tell You » reprend la même formule, le synthé sifflant sa mélodie au dessus des doux accords de Matt Hollywood.
Puis on revient au rythme plus énergique du début, qui se voit doté d’une touche acoustique rappelant les origines Californiennes du gang sur « Remember Me This ». Alors, comme d’habitude, il y aura toujours des petits malins pour critiquer ces références si visibles, afin de conclure qu’il vaut mieux ressortir ses originaux poussiéreux.
Certes, ce n’est pas un disque comme celui-là qui révolutionnera quoi que ce soit. Mais en a-t-il besoin ? A une époque de grand inventaire, « Brian Jonestown Massacre » creuse le sillons trop peu fréquenté du minimalisme ambitieux. Le premier album du Velvet était un monument construit avec les méthodes les plus rudimentaires, et plus de trente ans plus tard, Brian Jonestown Massacre se réapproprie ces humbles procédés.